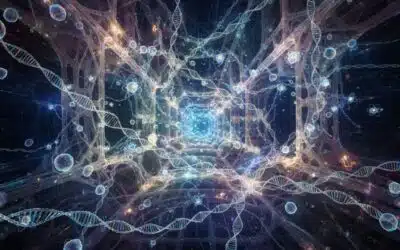Les trois manières de contenter les maîtres

Écrit par Paul Baffier
Blog | Les bases du Dzogchèn
Dans “Les trois manières de contenter les maîtres”, Paul nous offre une grille de lecture traditionnelle pour structurer pensée et action.
Série : Comment pratiquer le chemin du Dzogchèn ?
Les trois manières de contenter les maîtres
Comment se comporter avec un maître ? Après les premières rencontres et le déclic initial, c’est une question que l’on se pose, tôt ou tard. Les “trois manières de contenter les maîtres” ou “trois types de service” (zhabs tog rnam gsum) sont une petite grille de lecture traditionnelle utile, qui permet de structurer notre pensée et notre action à ce niveau.
Si l’on est un étudiant “pourvu des trois qualités” (à l’intelligence aiguisée désireuse d’apprendre, à la parole mesurée, et respectueux du maître), on utilisera ses qualités selon les trois méthodes suivantes :
- L’offrande de la pratique (sgrub pa’i mchod pa)
- Le service par le corps et la parole (lus ngag gi zhab tog)
- L’offrande des biens matériels (zang zing gi ‘bul ba)
“Il s’agit donc d’offrir des conditions optimales pour que la transmission se passe et que la clarté se fasse jour dans les esprits. Pas si facile quand tout le monde court comme des poulets sans tête ! Garder la tête froide est de la plus haute importance.”
1.
La première manière de contenter les maîtres est de pratiquer leurs enseignements. Cela n’a l’air de rien, mais de nos jours, avec nos emplois du temps surchargés, notre saturation perpétuelle et notre procrastination légendaire (la frénésie et l’apathie étant les deux faces du même oubli), ce n’est pas si évident. Rappelons que procrastinare vient **d’akrasia en grec, qui signifie “agir à l’encontre de son meilleur jugement” – intéressant, n’est-ce pas ?
Cela dit, quand on y réfléchit, que faire d’autre que cela ? Appliquer les instructions du maître. La tradition dit que la compassion du maître est telle qu’il prend naissance sous les oripeaux d’un humain pour enseigner aux êtres errants dans le cycle sans fin d’existences de souffrance. Donc, venir aux enseignements sans rien retenir, sans rien réviser, sans rien mettre en application dans sa vie quotidienne et dans des temps de retraite, bref, rester bouche bée le séant sur sa chaise, ce serait un peu bête, non ?
Par ailleurs, on peut lire le tibétain sgrub (”pratique”) comme signifiant aussi “réalisation” : les biographies traditionnelles (”namthar”, tib. rnam thar) présentent ainsi des cas où, après bien des années, le disciple vient réjouir son maître en lui faisant offrande de la réalisation des instructions. Ainsi de Jigmé Gyalwai Nyugu qui, après un harassant labeur ayant failli lui coûter la vie, revient voir l’Omniscient Jigmé Lingpa pour lui décrire les caractéristiques de la quatrième vision de Thögäl (tib. thod rgal), la fin du chemin du Dzogchèn. Et le Maître de se réjouir : “Fils, c’est exactement cela. Tu as atteint le niveau qu’on appelle l’épuisement des phénomènes au sein du réel (chos nyid du ‘dzin pa zad pa’i snang ba)”. [1]
Donc, “offrir sa pratique”, c’est agir selon les instructions pour que les précieuses existences du maître et du disciple deviennent une conjonction pleine de sens, une rencontre merveilleuse.
2.
La seconde manière de contenter les maîtres est de servir leur activité : par le corps, en organisant tout ce qui est nécessaire pour le bon déroulement de l’enseignement. Cela va des réservations de salles à servir le café, de penser au repas comme à l’hôtel ; cela va de la construction du temple ou du centre de retraite à la conduite du véhicule lors des déplacements (char à boeufs ou voiture-turbo, pur-sang ou coracle, jet ou yak), de la composition du menu à la bonne tenue des comptes,- bref ! C’est l’organisation de toute la logistique pour que le ou la maître puisse se concentrer sur l’essentiel de sa tâche : la transmission.
Il s’agit donc d’offrir des conditions optimales pour que la transmission se passe et que la clarté se fasse jour dans les esprits. Pas si facile quand tout le monde court comme des poulets sans tête ! Garder la tête froide **est de la plus haute importance.
Quant à “servir par la parole”, c’est aussi bien savoir poser les bonnes questions au bon moment pour demander l’enseignement (et pour cela, il faut d’abord étudier. cf. https://dzogchentoday.org/fr/un-temps-dobservation/), que savoir répondre aux questions posées par l’enseignant pour vérifier si l’enseignement précédent a été intégré (et pour cela, il faut… oui, j’insiste. cf. https://dzogchentoday.org/fr/les-qualites-dun-disciple-selon-la-tradition/). C’est aussi, plus traditionnellement, faire les louanges et les requêtes de longue vie, énoncer toutes les prières de souhaits favorables au développement de l’activité et la préservation d’une lignée de réalisation authentique, dédiée au bien des êtres qui la rencontreront.
Dans l’idéal, ce serait savoir prendre la parole au service des éveillés, en redonnant leur enseignement sans rien ajouter ni retrancher, tout en l’adaptant à l’évolution des conditions de vie et de pensée.
3.
La dernière manière est sans doute celle qui est la plus mal comprise : le don de biens matériels. Ce n’est pas l’aumône, ce n’est pas la charité.
C’est d’un côté, pour nous autres obnubilés par notre attachement aux supports matériels, un travail de lâcher-prise. On raconte ainsi que le grand maître dzogchèn Patrul Rinpoché laissait derrière lui les monceaux d’offrandes qu’on lui avait offert. Traditionnellement, on offrait des animaux de bas, des chevaux, tout ce qui permettait un apport de force laborieuse dans un monde très peu “machinisé”.
Mais, dans notre ère de démultiplication des objets matériels où tout semble à portée de main et facilement achetable, ce sur quoi il faudrait peut-être bien travailler, c’est le “dieu argent” ; sa force faussement rassurante et le sentiment de protection irrépressible qu’il donne. Vérification : il suffit de (croire) ne plus en avoir pour que la panique nous gagne – comme si en avoir nous faisait devenir immortel. C’est donc – c’est le cas de le dire – “une valeur-refuge”, très illusoire.
Le “don de biens matériels”, c’est, d’un autre côté, le soutien à l’établissement de lieux-refuges pour la pratique spirituelle, qu’il s’agisse de lieux numériques (site internet) ou de lieux géographiques (centre de retraite). Ce sont ces lieux qui nous aident à étudier et intégrer notre pratique, dans l’action au quotidien ou dans le temps de retrait pour l’approfondissement. Les aider à les construire, les préserver et les entretenir est fondamental pour la pérennité des enseignements spirituels menacés de dispersion. Il faut des lieux de force où leur souffle reste vivant, palpable, présent, où les êtres engagés sur le chemin peuvent les vivre pleinement. On raconte ainsi que Namkhai Norbu Rinpoché avait lui-même porté les premières pierres du grand temple de Tenerife.
On le voit, ces “trois manières de servir les maîtres” recoupent aussi bien les trois types de générosité (don d’un enseignement spirituel, don de protection contre les dangers, don de ce qui est nécessaire) que le triptyque de l’écoute, de la réflexion et de la méditation.
On les appelle aussi, en une seule expression, “la manière de suivre le maître par l’application” (sbyor bas bsten tshul) : s’appliquer (sbyor ba), c’est alors rentrer en action (sbyor ba), en union (sbyor ba) à la bénédiction du Maître, c’est le principe du yoga (sbyor ba).
[1] Merveilleuse Danse Illusoire, Autobiographie de Khenchen Ngawang Palzang Eusèl Rinchèn Nyingpo Péma Lédrel Tsal, Padmakara. RETOUR
Plus d’articles
Lumière d’étoiles
Dans "Lumière d'étoiles", Mila Khyentse parle des nuits d'hiver, de la lumière des étoiles et de celle de l'esprit. Il suffit de lever les yeux !
La transmission tibétaine : la transmission selon les 4 initiations du Vajrayana
La transmission tibétaine, selon les 4 initiations du Vajrayana, mène à la complète réalisation de la nature ultime de toute réalité.
Base de tout Künshi
Cet article intitulé « Base de tout, Künshi » permet de mieux comprendre les mots et concepts essentiels du Dzogchen.